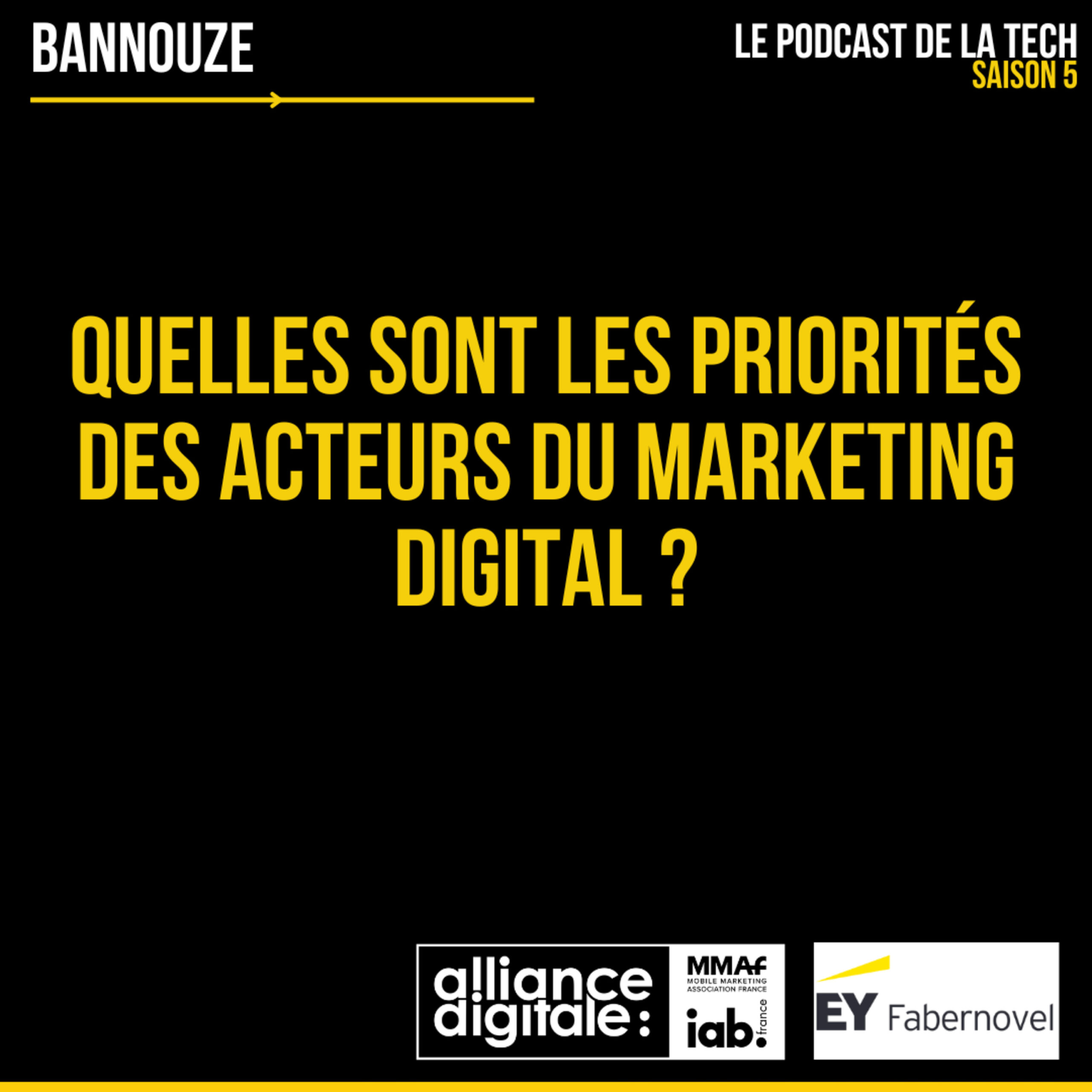Quelles sont les priorités des acteurs du marketing digital ?
Après deux épisodes dressant une photographie précise du marché du marketing digital grâce à l’étude de l’Alliance Digitale, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Quelles sont les priorités, les enjeux et les difficultés concrètes des professionnels du secteur ? Pour en discuter, nous recevons Jean-Baptiste Rouet, Chief Digital & Programmatic Officer chez Publicis Media, et Pierre Devoize, Directeur Général Adjoint de l’Alliance Digitale. Ensemble, nous allons décrypter les trois grands chantiers qui animent l’écosystème : la fin des cookies tiers, l’hégémonie des GAFA et l’omniprésence de la privacy.
Jean-Baptiste Rouet, fort de 20 ans d’expérience chez Publicis Media, apporte une vision stratégique sur les sujets programmatiques, cookieless et la mutation des audiences. De son côté, Pierre Devoize, en charge des Affaires Publiques à l’Alliance Digitale, a piloté l’étude qui sert de toile de fond à notre discussion. C’est un dialogue au cœur des préoccupations de toute une filière qui s’engage.
La fin des cookies tiers : une menace ou une opportunité pour l’écosystème publicitaire ?
C’est un serpent de mer, une blague récurrente dans le milieu. Chaque année, on nous annonce la fin des cookies tiers. Pourtant, 2024 semble être la bonne. Ou peut-être pas. Quelle est la situation réelle et quelles en sont les conséquences pour les acteurs du marché ?
Le calendrier incertain de la Privacy Sandbox de Google
Jean-Baptiste Rouet rappelle avec une pointe d’ironie : « C’était un peu comme l’année du mobile. Pour le coup, le projet Privacy Sandbox c’est 2018. En 2020, ils annoncent une date en 2022 pour la fin des cookies tiers, et finalement c’était reporté à 2024. » Il précise que cette année, on peut effectivement s’attendre à cette disparition, mais avec des réserves importantes. « Il y a quand même des tests qui sont en cours au sein de l’écosystème. Et ces tests vont être soumis à l’analyse de la CMA, donc l’autorité de concurrence britannique qui devra se prononcer. »
Cette analyse, qui peut durer jusqu’à 120 jours, portera sur les faiblesses de la Privacy Sandbox, déjà pointées du doigt par le Tech Lab dans un rapport récent et dense. Pour Jean-Baptiste, « il est probable qu’il y ait un travail côté Google à reproduire ». Loin d’être une catastrophe, il considère que cette transition pourrait être bénéfique : « Je pense que pour l’industrie, notamment pour les médias, ce serait plutôt une bonne nouvelle qu’on se débarrasse des cookies tiers. » Une initiative que Google prend, non par altruisme, mais sous la pression réglementaire du RGPD.
Les alternatives aux cookies tiers : vers un bénéfice pour les médias ?
Mais pourquoi se réjouir de la fin d’un standard qui a structuré le web pendant des années ? La réponse réside dans l’évolution des usages. « Aujourd’hui, le format narratif plébiscité, c’est l’audio et la vidéo principalement », explique Jean-Baptiste. Entre TikTok, YouTube, l’audio et la télévision connectée, les environnements sans cookies se multiplient. « Le cookie tiers ne te permet pas de suivre tes audiences et d’ailleurs, il suit très mal tes audiences. »
Cette obsolescence a des conséquences directes sur l’efficacité des campagnes. En se basant sur les cookies, « tu surestimes par deux ta couverture et tu sous-estimes ta répétition. Donc en fait, cet indicateur-là, il faut arrêter parce qu’il n’a plus de sens aujourd’hui. » La fin du cookie tiers pousse donc le marché à innover et à se tourner vers des solutions plus robustes. Jean-Baptiste cite plusieurs initiatives : « On a First ID de nos amis français, on a ID5… il y a tout un tas de solutions. » Ces solutions se divisent en trois catégories : les probabilistes, peu fiables ; les approches mixtes, meilleures mais encore imparfaites ; et les solutions déterministes, qui ont la faveur des experts. Ces dernières s’appuient sur des données loguées, notamment celles des broadcasters TV, des plateformes et surtout du retail media, en plein essor.
Une initiative se détache particulièrement : « Il y a une initiative qui s’appelle Utic aussi qui est hyper intéressante parce qu’elle est européenne. C’est des telcos, donc on va dire que derrière c’est robuste, qui a la couverture parce qu’on est tous abonnés chez l’un ou chez l’autre. » Avec Orange, Bouygues, SFR et bientôt Free, Utic couvrira l’ensemble du marché français et s’étendra aux cinq plus grands marchés européens, offrant une solution paneuropéenne crédible. « Là, on a quelque chose d’intéressant puisqu’on a le reach. »
L’inertie du marché et les défis de l’adoption
Si les solutions existent et que les éditeurs sont « très à la pointe » et « très volontaires », l’adoption reste un défi majeur. Pierre Devoize soulève un point crucial : la difficulté pour les plus petits acteurs de s’adapter. « Ce qu’on observe, c’est qu’il est très difficile pour un acteur lambda de pouvoir tester les API de la Privacy Sandbox. Ça coûte très cher, ça demande des expertises que les entreprises en majorité n’ont pas. » Cette barrière à l’entrée handicape 90% des membres de l’Alliance Digitale, en particulier les médias dont la préparation aux tests est relativement faible, alors que l’échéance approche à grands pas.
Jean-Baptiste confirme cette inertie côté demande : « Il y a une inertie folle, il faut dire que Google nous a un peu habitués. À force de reporter, les annonceurs se sont un peu mis en retrait en attendant d’avoir le code final pour démarrer. » Cette situation crée une inquiétude palpable. Comme le souligne Pierre, les conséquences à court terme sont difficiles à modéliser : « On peut être inquiet que certaines entreprises vont subir des pertes de chiffre d’affaires assez importantes. »
Hégémonie des GAFA : comment assurer une juste répartition de la valeur ?
La fin des cookies tiers ne se déroule pas dans un vide concurrentiel. Elle s’inscrit dans un marché déjà extrêmement concentré, où la question de la domination des grandes plateformes est centrale. Comment éviter que cette transition ne renforce encore leur position ?
La concentration du marché, une menace pour la concurrence
Pierre Devoize pose clairement le problème : « Quelles impacts ça va avoir sur la concentration du marché ? […] Est-ce que l’avènement de la Privacy Sandbox sur le navigateur Chrome va dans la bonne direction ? Probablement pas, puisque ça veut dire qu’un acteur dominant comme Google va pouvoir même renforcer son écosystème fermé. » Il pointe une « inégalité assez crasse » entre les écosystèmes fermés (les GAFA) qui disposent d’une quantité de données identifiées indépassable, et le reste du monde (éditeurs, adtechs) qui a besoin du partage de données pour survivre.
Cette concentration de la valeur est un sujet de préoccupation majeur pour les agences. Jean-Baptiste explique : « Chez Publicis, on est vraiment très, très préoccupé par ce souci de ‘fair share’. C’est la juste répartition de la valeur entre ces plateformes américaines et chinoise avec TikTok, et les médias, ceux qui produisent des contenus, ceux qui ont des rédactions. » Il rappelle une réalité économique brutale : « Il y a très peu de plateformes qui concentrent énormément de valeur et il y a beaucoup de médias qui se répartissent une part de gâteau de plus en plus petite. » Les études, comme celle de l’Arcom, confirment cette tendance avec une part de marché des médias traditionnels qui devrait continuer à diminuer d’ici 2030, représentant une perte potentielle de 800 millions d’euros.
Le rôle crucial des annonceurs et des agences pour un écosystème équilibré
Face à ce constat, qui peut agir ? L’animateur Laurent Perez-Petit le suggère : « Le meilleur sponsor, c’est Jean-Baptiste, parce que c’est les clients de Jean-Baptiste aussi qui peuvent orienter leur achat média. Celui qui a de la force, c’est celui qui achète finalement. » Les annonceurs financent toute l’industrie et leurs choix sont déterminants.
Jean-Baptiste reconnaît cette responsabilité : « C’est le rôle de l’agence. Nous, on a une chance incroyable, c’est d’être vraiment au centre des sujets. » L’agence a un devoir d’éducation auprès des annonceurs pour les guider dans cet environnement complexe et leur faire prendre conscience des enjeux. Cela passe par la construction d’alternatives viables aux plateformes. « C’est grâce à des données déterministes, au programmatique qu’on peut reconstituer [des audiences de qualité]. En fait, on refait une plateforme avec une base média plutôt que de toucher des fils différents sur Facebook ou Instagram. On va toucher des individus à travers tous ces médias. » Il s’agit de contrebalancer la puissance commerciale des plateformes qui « entourent les clients et passent beaucoup de temps chez eux ».
La dépendance des éditeurs et la nécessité de réinventer les modèles
La question de la cohabitation entre GAFA et éditeurs est posée. Les plateformes ont-elles encore intérêt à collaborer avec les médias ? La tendance semble plutôt au retrait. Jean-Baptiste rappelle : « On voit que Meta a supprimé en septembre dernier la rubrique Actu parce qu’il n’a pas envie de payer clairement d’argent aux médias. » Google, de son côté, semble se concentrer sur ses forteresses : le Search et YouTube, où le cookie tiers n’est pas nécessaire et où la donnée logguée est reine. Pour le reste, c’est « débrouillez-vous avec les indépendants ».
Pour Pierre Devoize, la question doit être retournée : « Comment limiter la dépendance des éditeurs aux grandes plateformes et leur permettre de mieux monétiser leurs inventaires ? » Car la presse est en lien avec les GAFA sur l’ensemble de ses sources de financement : publicité, abonnements, droits voisins. C’est un sujet de société qui dépasse le cadre strict du marketing digital.
La privacy au cœur des débats : entre protection des utilisateurs et frein à l’innovation
Le troisième pilier des préoccupations actuelles est la réglementation sur la vie privée. GDPR, DSA, DMA… ces acronymes structurent désormais le marché. Mais ces normes, si elles protègent le consommateur, ne risquent-elles pas d’entraver l’innovation et de créer de nouvelles inégalités ?
Le RGPD : un déséquilibre concurrentiel à l’échelle mondiale ?
Face à l’idée que la réglementation n’empêche pas l’innovation, Pierre Devoize apporte une nuance de taille. « Il faut se remettre dans un contexte où la concurrence qui se fait aujourd’hui, elle se fait au niveau mondial. Et que les entreprises qui nous arrivent et qui sont les principales concurrentes des entreprises européennes, elles, elles n’ont pas à le faire [respecter le RGPD dès le départ]. » Ces entreprises peuvent développer des produits plus rapidement, inonder le marché et se préoccuper de la conformité plus tard. Cela crée un déséquilibre majeur.
« Ce que je dis, ce n’est pas que le RGPD est une mauvaise réglementation », précise-t-il. Au contraire, il a instauré une prise de conscience mondiale. « Ce qu’on dit, c’est qu’il y a un déséquilibre qui se fait entre les différentes régions du monde et qui nécessairement a des impacts sur l’innovation et la concurrence des entreprises. » De nombreuses études économiques ont d’ailleurs démontré que le RGPD avait fragilisé les petites et moyennes entreprises au détriment des plus grosses, qui ont les moyens de se mettre en conformité.
L’interprétation des textes et l’enjeu du futur règlement ePrivacy
Le problème ne vient pas seulement du texte lui-même, mais de son interprétation. Le RGPD devait être complété par le règlement ePrivacy, qui n’a toujours pas vu le jour. Ce vide laisse une marge d’interprétation importante aux autorités de protection des données, qui peut varier d’un pays à l’autre de l’UE.
Pierre Devoize soulève un paradoxe : « Il y avait un niveau d’obligation équivalent entre une donnée identifiante granulaire de Laurent […] et un cookie pseudonyme. Et donc là, la question c’est : qui ça avantage dans ce cas-là ? Ceux qui ont la donnée pseudonyme ou ceux qui ont les données identifiées granulaires ? » La réponse est évidente : cela avantage les grandes plateformes qui possèdent déjà ces données identifiées. L’Alliance Digitale porte ce sujet en vue de l’évaluation du RGPD par la Commission européenne en mai 2024, espérant alimenter le débat pour un cadre plus équilibré.
En conclusion, les acteurs du marketing digital naviguent dans une période de mutation intense. La fin des cookies tiers, loin d’être un simple changement technique, redessine les rapports de force. Elle offre une chance historique aux médias de se réinventer, mais elle exige des investissements et une agilité que tous n’ont pas. Face à la concentration du pouvoir des GAFA, la responsabilité est collective : annonceurs, agences et éditeurs doivent collaborer pour construire un écosystème plus juste et plus durable. Enfin, le cadre réglementaire de la privacy, bien que fondamental, doit être pensé pour ne pas étouffer l’innovation européenne. Le futur sera sans doute plus complexe, mais comme le dit Jean-Baptiste, « finalement, c’est beaucoup plus excitant que ce cookie tiers qui commençait à vraiment dépérir ».
FAQ sur les priorités du marketing digital
Quelles sont les principales alternatives aux cookies tiers en 2024 ?
Les alternatives se développent rapidement et reposent sur des données plus fiables. On trouve des solutions basées sur des identifiants uniques comme First ID ou ID5, des approches utilisant les données loguées des retailers (retail media) et surtout des initiatives structurantes comme Utic, portée par les grands opérateurs télécoms européens, qui promet une couverture et une robustesse inégalées.
« Il y a une initiative qui s’appelle Utic aussi qui est hyper intéressante parce que elle est européenne. C’est des telcos, donc on va dire que derrière c’est robuste, qui a la couverture. […] Tu auras les quatre opérateurs qui couvrent tout le marché qui vont rejoindre l’initiative. » – Jean-Baptiste Rouet
Pourquoi la fin des cookies tiers est-elle une opportunité pour les médias ?
Elle est vue comme une opportunité car le cookie tiers était un standard imprécis et obsolète, inadapté aux nouveaux usages (vidéo, audio, TV connectée). Sa disparition force le marché à se tourner vers des solutions basées sur des données de meilleure qualité, comme les données ‘first-party’ des éditeurs, ce qui leur permet de mieux valoriser leurs audiences et de reprendre le contrôle.
« Je pense que pour l’industrie, notamment pour les médias, ce serait plutôt une bonne nouvelle qu’on se débarrasse des cookies tiers. […] les médias ont beaucoup à gagner à utiliser des alternatives à ce fameux cookie tiers. » – Jean-Baptiste Rouet
Qu’est-ce que la Privacy Sandbox de Google et pourquoi est-elle critiquée ?
La Privacy Sandbox est l’ensemble des solutions proposées par Google pour remplacer les cookies tiers dans son navigateur Chrome. Elle est critiquée car elle est complexe et coûteuse à tester pour la majorité des acteurs du marché, et elle est soupçonnée de renforcer l’écosystème fermé de Google, au détriment de la concurrence et du web ouvert.
« Il est très difficile pour un acteur lambda de pouvoir tester les API de la privacy sandbox. Ça coûte très cher. Ça demande des expertises que les entreprises en majorité n’ont pas. » – Pierre Devoize
Comment l’hégémonie des GAFA affecte-t-elle les éditeurs de presse ?
L’hégémonie des GAFA se traduit par une concentration massive des revenus publicitaires entre leurs mains. Cela laisse une part de plus en plus faible du gâteau publicitaire aux éditeurs de presse, qui produisent pourtant le contenu. Cette situation crée une forte dépendance économique et menace la viabilité de nombreux médias.
« Il y a très peu de plateformes qui concentrent énormément de valeur et il y a beaucoup de médias qui se répartissent une part de gâteaux de plus en plus petite. » – Jean-Baptiste Rouet
Quel est le rôle des annonceurs dans l’équilibre du marché publicitaire digital ?
Les annonceurs financent l’ensemble de l’écosystème publicitaire. Leurs décisions d’investissement ont donc un pouvoir considérable. En choisissant d’allouer une part de leurs budgets à des médias de qualité plutôt qu’uniquement aux grandes plateformes, ils peuvent activement contribuer à un marché plus équilibré et soutenir la diversité éditoriale.
« Les annonceurs financent l’industrie de la publicité, c’est évident. Et toute la chaîne de valeur. » – Jean-Baptiste Rouet
En quoi le RGPD peut-il freiner l’innovation pour les entreprises européennes ?
Bien que protecteur pour les utilisateurs, le RGPD impose des contraintes fortes aux entreprises européennes dès la conception de leurs produits. Leurs concurrents mondiaux, notamment américains ou chinois, peuvent développer et lancer des produits plus rapidement sans ces contraintes initiales, créant ainsi un déséquilibre concurrentiel qui peut freiner l’innovation en Europe.
« Ce qu’on dit, c’est qu’il y a un déséquilibre qui se fait entre les différentes régions du monde et qui nécessairement a des impacts sur l’innovation et la concurrence des entreprises. » – Pierre Devoize
Pourquoi est-il si difficile de tester les nouvelles solutions post-cookies ?
Les tests sont difficiles car ils requièrent des expertises techniques pointues, des ressources financières importantes et du temps. De plus, l’inertie de certains grands acteurs technologiques, qui ont tardé à intégrer les nouvelles API, et les retards successifs de Google ont ralenti la préparation de l’ensemble de l’écosystème.
« Côté annonceur, côté by side, il a fallu attendre janvier pour qu’on puisse commencer à avoir des DSP self-serve qui nous permettent de tester la privacy sandbox. » – Jean-Baptiste Rouet
Qu’est-ce que le ‘fair share’ dans le contexte de la publicité digitale ?
Le ‘fair share’ désigne le principe d’une juste répartition de la valeur publicitaire entre tous les acteurs de la chaîne. Il s’agit de s’assurer qu’une part équitable des investissements des annonceurs revienne aux créateurs de contenu (les médias) et ne soit pas majoritairement captée par les intermédiaires technologiques et les grandes plateformes.
« Chez Publicis, on est vraiment très, très préoccupé par ce souci de ‘fair share’. C’est la juste répartition de la valeur entre ces plateformes […] et les médias, ce qui produisent des contenus, ce qu’ont des rédactions. » – Jean-Baptiste Rouet