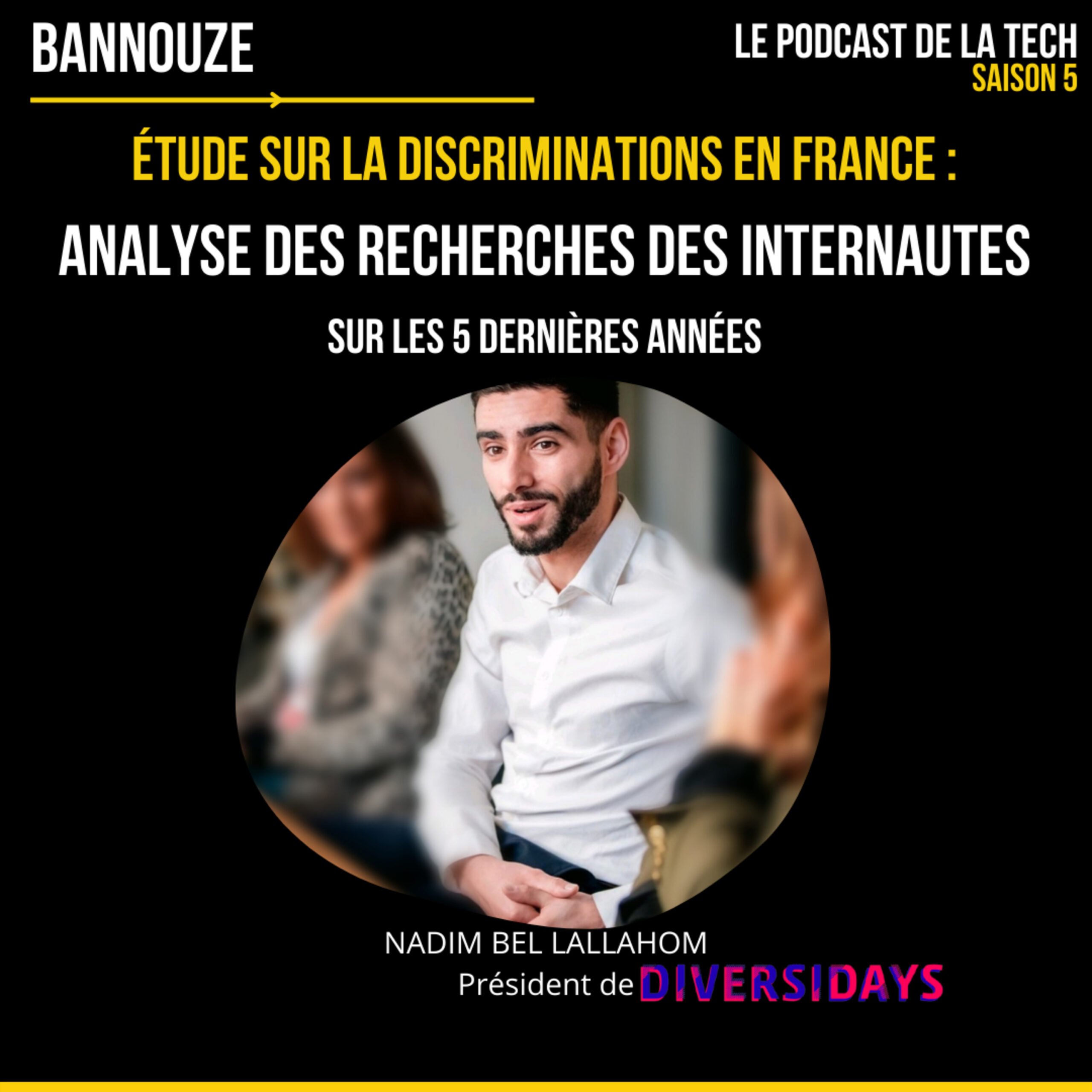Derrière le miroir de Google : ce que les recherches des Français nous disent vraiment sur la diversité et l’inclusion
Lorsque l’on m’a proposé de participer à ce podcast, j’ai tout de suite accepté. Non pas seulement pour parler de notre association, Diversidays, mais pour partager quelque chose de plus profond, une sensation que mon interlocuteur, Laurent, a parfaitement résumée : un mélange de ‘joie et de tristesse’. C’est exactement ce que nous avons ressenti en analysant les résultats de notre dernière étude, menée en partenariat avec Google. La joie de voir une quête de sens, une volonté de comprendre et d’agir. Et la tristesse de constater que, oui, en 2024, nous avons encore besoin de résoudre des problèmes qui devraient appartenir au passé. Ces émotions contradictoires sont le moteur de notre action. Elles nous rappellent pourquoi il est si crucial de ne plus se contenter d’intuitions ou d’opinions, mais de s’appuyer sur des faits, des données brutes, pour comprendre où nous en sommes réellement.
La genèse de cette étude part d’un constat simple et désarmant : sur les sujets de diversité et d’inclusion, nous manquons cruellement de chiffres. Comment mener une action efficace si l’on ne sait même pas de quoi l’on parle ? Une de nos précédentes études avait révélé un chiffre qui, à lui seul, justifie tout notre travail :
’46 % des salariés en entreprise ne comprennent même pas le mot diversité’.
Ce chiffre est vertigineux. Il signifie que près de la moitié des gens pour qui nous essayons de construire un environnement de travail plus juste et plus représentatif ne saisissent pas l’enjeu fondamental. Face à ce mur d’incompréhension, il fallait trouver un moyen de prendre le pouls de la société, de manière non filtrée, authentique. C’est là que notre partenariat de longue date avec Google a pris tout son sens.
Quand on pense à Google, on pense au moteur de recherche, cette immense bibliothèque des pensées humaines. Nous nous sommes dit : et si on ouvrait le capot ? Si on essayait de comprendre, au-delà des débats médiatiques et politiques souvent polarisés, quelles sont les véritables questions que les Françaises et les Français se posent ? Qu’est-ce qui les préoccupe la nuit, les interroge au quotidien sur le handicap, le racisme, le sexisme, l’identité ? Cet article n’est pas un manifeste. C’est le partage factuel et bienveillant des enseignements que nous avons tirés, une photographie de nos aspirations et de nos peurs collectives, destinée à éclairer, à inspirer et, je l’espère, à donner à chacun les clés pour agir.
La genèse d’une étude essentielle : pourquoi nous avons ouvert le capot de Google
Avant de plonger dans les résultats, il est essentiel de comprendre le ‘pourquoi’ de cette démarche. Chez Diversidays, notre mission est de changer le visage de la tech pour qu’il ressemble davantage à la société française. Mais pour changer une situation, il faut d’abord la mesurer. Or, dans l’univers de la diversité et de l’inclusion, nous naviguons souvent à vue, au gré des ressentis et des anecdotes. C’est un socle trop fragile pour construire des stratégies d’impact. Le manque de données tangibles est le premier frein à l’action. Il permet aux biais de persister et aux vieilles habitudes de s’installer confortablement. Sans chiffres, le ‘ce n’est pas un problème chez nous’ a encore de beaux jours devant lui.
Un partenariat de confiance pour accéder à une mine d’or
L’idée de collaborer avec Google sur ce sujet est née naturellement de notre relation de confiance. Nous savions qu’ils détenaient une ressource inestimable : l’historique anonymisé des requêtes. C’était l’opportunité unique d’écouter la voix collective de la France, sans le filtre des sondages où les réponses peuvent être influencées par la désirabilité sociale. Le moteur de recherche, c’est un peu
‘l’ami à qui on pose des questions’
sans oser les poser à voix haute. Le processus n’a pas été simple. Il a fallu négocier, discuter, définir un cadre précis pour accéder à ces informations tout en respectant une confidentialité absolue. Ce fut un véritable ‘travail d’aller-retour’, mais la volonté commune de faire avancer le sujet a primé. Au final, Google nous a ouvert les portes d’une analyse comparative sur plusieurs années, nous permettant de voir des évolutions significatives entre 2007, 2013, 2017 et 2022. Cette profondeur historique est ce qui donne toute sa force à l’étude.
Un objectif clair : passer du dogme aux faits
Notre intention n’a jamais été de produire un rapport dogmatique ou moralisateur. Au contraire, nous voulions sortir de la sémantique du ‘combat’, omniprésente dans les médias, qui peut parfois être contre-productive et braquer les gens. Les mots comme ‘lutte contre le sexisme’, ‘combat contre le racisme’ sont nécessaires, mais ils peuvent aussi donner l’impression d’un conflit permanent. Notre approche était différente : que cherchent concrètement les gens ? Quelles sont leurs interrogations pratiques, leurs besoins d’information ? En analysant les termes associés à des mots comme ‘racisme’, nous avons découvert une complexité fascinante. Oui, il y a des requêtes inquiétantes comme ‘blague raciste’, mais il y a aussi une tendance de fond incroyablement positive : une recherche croissante de contenus culturels engagés, tels que ‘cinéma qui dénonce le racisme’ ou ‘séries qui dénonce le racisme’. C’est le signe d’une société qui cherche à s’éduquer, à comprendre à travers des récits. C’est précisément ce type de nuance que seule une analyse de données à grande échelle peut révéler.
Ce travail de fond, je tiens à le souligner, a été mené avec une rigueur immense par nos équipes, et notamment par Chloé, notre responsable communication et études. C’est elle qui a transformé des milliards de points de données brutes en une analyse intelligible et pleine de sens. C’est cette approche factuelle, presque clinique, qui rend l’étude si puissante et, comme l’a dit Laurent, ‘super agréable à lire’. Elle ne juge pas, elle expose. Et c’est en exposant les faits que l’on peut espérer initier un changement durable.
De ‘contre’ à ‘pour’ : le changement de paradigme révélé par nos recherches
Le premier enseignement majeur, et sans doute le plus porteur d’espoir de notre étude, est une évolution sémantique subtile mais fondamentale. Nous observons un glissement progressif d’un vocabulaire de l’opposition vers un vocabulaire de l’action positive. Historiquement, les requêtes liées à la discrimination étaient formulées en termes de lutte. On tapait ‘lutte contre le sexisme’, ‘lutte contre le racisme’, ‘lutte contre le validisme’. Cette sémantique de combat, bien que toujours présente car les combats ne sont pas gagnés, laisse de plus en plus de place à une nouvelle forme de recherche, beaucoup plus proactive et constructive.
Quand la recherche devient une quête de solutions concrètes
Aujourd’hui, nous voyons une augmentation significative des requêtes formulées avec la préposition ‘pour’. Les gens ne cherchent plus seulement à comprendre ce qu’est un problème, ils cherchent comment faire partie de la solution ou comment obtenir de l’aide. Cela se traduit par des recherches très pratiques qui montrent que les sujets ne sont pas toujours aussi politisés qu’on le pense. Par exemple, une personne ne va pas forcément taper ‘idéologie LGBT’, mais plutôt ‘association LGBT dans mon quartier’. Une autre ne cherchera pas ‘débat sur le handicap’, mais plutôt
‘c’est quoi le statut RQTH pour les personnes en situation de handicap’.
On passe d’un débat d’idées, souvent abstrait, à une recherche de services, de soutien, d’informations utiles au quotidien. C’est une maturité collective. Les Français ne se contentent plus de constater les injustices, ils cherchent activement des outils pour y faire face ou pour aider les autres.
L’information qualifiée comme nouveau champ de bataille
Ce passage au ‘pour’ signifie aussi une demande croissante d’informations qualifiées. Les gens veulent agir, mais ils veulent bien agir. Cela représente une opportunité immense pour les associations, les entreprises et les services publics. Si les gens cherchent des ressources, nous devons les leur fournir. L’étude devient alors une véritable mine de trésors pour quiconque souhaite créer du contenu pertinent. Elle nous dit : ‘voilà les questions précises que les gens se posent, voilà les informations dont ils ont besoin’. Si une entreprise veut s’engager sur le handicap, elle sait désormais qu’expliquer simplement et clairement les démarches pour obtenir le statut RQTH répond à un besoin réel et massif. Si une association veut lutter contre l’homophobie, elle sait que créer un annuaire local de lieux sûrs et d’associations de soutien aura un impact direct. Nous sortons de la communication de grands principes pour entrer dans l’ère de l’utilité pratique. Et c’est là que le véritable changement s’opère.
Les vérités inconfortables que nous révèle le miroir de nos recherches
Si l’étude apporte de l’espoir, elle met aussi en lumière des aspects plus sombres et complexes de notre société. C’est la fameuse ‘tristesse’ évoquée en introduction. Certaines requêtes récurrentes sont le symptôme de malaises profonds qui traversent le corps social et nous obligent à nous interroger sur les normes que nous créons et entretenons collectivement. Elles nous rappellent que malgré les progrès, les combats pour l’acceptation de soi et des autres sont loin d’être terminés.
‘Suis-je normal ?’ : La requête angoissante d’une société en quête de validation
Une des requêtes qui nous a le plus marqués, et qui ressort de manière transversale, est ‘suis-je normal ?’. Cette question, simple et terrible, révèle une anxiété profonde. Elle traduit le besoin constant de se comparer, de se situer par rapport à une norme supposée. On peut y voir sans peine l’influence de l’essor des réseaux sociaux, d’une culture de l’image où chacun est sommé de présenter une version idéalisée de lui-même. Cette quête de normalité se décline de manière très concrète. Une sous-requête qui a émergé est, par exemple,
‘mec torse normal’
. Qu’est-ce qu’un torse ‘normal’ pour un homme ? Cette question, en apparence triviale, en dit long sur la pression esthétique et la comparaison permanente qui pèsent sur les individus. C’est le signe que beaucoup de gens se sentent en décalage, en insécurité, et cherchent dans l’anonymat de Google une validation ou une réponse à leur inquiétude. C’est un vrai sujet de société sur la définition de la normalité et la place que nous laissons à la diversité des corps, des esprits et des parcours.
Le rôle crucial des rôles modèles pour créer de nouvelles normes
Face à cette quête de normalité, l’étude montre heureusement une autre tendance : la recherche de représentation. Les gens cherchent des figures auxquelles s’identifier, des ‘rôles modèles’ qui prouvent qu’un autre chemin est possible. Sur chaque thématique, des personnalités émergent. Concernant le handicap, par exemple, le nom de Théo Curin, athlète paralympique, ressort fréquemment. On voit aussi des noms de politiques comme Sophie Cluzel. Ces personnalités, qu’elles soient sportives, politiques ou artistiques, jouent un rôle fondamental. Elles incarnent une réussite, une visibilité, et brisent l’isolement que peuvent ressentir certaines personnes. Elles montrent qu’on peut être en situation de handicap et accomplir des exploits, qu’on peut être une femme et diriger. Je suis convaincu qu’on n’aura jamais assez de rôles modèles. Certains pensent que c’est anecdotique, mais pour se sentir touché par une histoire, pour s’autoriser à rêver, il faut pouvoir voir des points communs avec ceux qui réussissent. Cette étude nous le confirme : la visibilité de parcours diversifiés est un levier de changement puissant. Elle permet de se dire : ‘si cette personne qui me ressemble l’a fait, alors peut-être que moi aussi, je peux le faire’.
Le paradoxe de la tech : un secteur d’avenir aux réflexes du passé
Le secteur de la tech est au cœur de la mission de Diversidays. C’est un univers fascinant, porteur d’innovations qui transforment nos vies. On pourrait logiquement s’attendre à ce qu’il soit à l’avant-garde des sujets sociétaux, y compris la diversité et l’inclusion. Pourtant, la réalité est tout autre. Quand on traverse les entreprises de la tech, on se rend compte que, bien que ce soit un milieu jeune et dynamique, la diversité n’est souvent pas au rendez-vous. Et ce n’est pas forcément par malveillance. Comme le disait Laurent, ce n’est même pas ‘quelque chose d’expressément voulu’. C’est presque pire : c’est un impensé.
La performance à tout prix : le piège du clonage
Pourquoi ce secteur, si tourné vers l’avenir, peine-t-il tant à refléter la société ? La réponse se trouve dans son modèle de croissance.
‘On est sur des modèles qui sont dans une quête de performance économique rapide’.
Une start-up de la tech est volatile, elle doit aller vite, innover constamment, lever des fonds. Dans cette course effrénée, l’efficacité à court terme devient la boussole principale. Et qu’est-ce qui est perçu comme le plus efficace ? Recruter des gens qui nous ressemblent. Comme le dit l’adage, ‘qui se ressemble s’assemble’. On recrute des personnes issues des mêmes écoles, avec les mêmes parcours, car on a l’impression qu’elles se comprendront plus vite, qu’elles seront opérationnelles immédiatement. Plusieurs études montrent que plus une entreprise met l’accent sur le ‘mérite’, plus elle a tendance à recruter des clones de ses dirigeants. C’est un biais cognitif puissant : on associe la ressemblance à la compétence.
L’anecdote du CTO : quand l’efficacité à court terme tue l’innovation
J’ai un exemple parfait qui illustre ce phénomène. J’ai un jour discuté avec le CTO d’une grande start-up du paiement. Il m’a confié, avec une sincérité désarmante : ‘J’ai essayé de recruter des personnes différentes de moi qui viennent de l’université, ça n’a pas fonctionné’. Intrigué, je lui ai demandé sur quoi il avait basé son évaluation. Sa réponse a été une révélation : ‘Sur la capacité à me comprendre très rapidement’. On touche ici au cœur du problème. Bien sûr, une personne qui n’a pas le même formatage, les mêmes codes, mettra peut-être un peu plus de temps à s’intégrer à une discussion technique. Mais cette friction initiale est précisément la source de l’innovation. Cette personne posera des questions différentes, apportera une perspective nouvelle, remettra en cause des évidences. L’ironie, c’est que des études de l’OCDE montrent que les start-ups les plus durables, celles qui survivent sur le long terme, sont celles qui ont le plus de diversité. La créativité naît de la confrontation des points de vue. En privilégiant l’efficacité de la communication à court terme, ce CTO se privait du carburant essentiel à la survie de son entreprise : les idées nouvelles.
Transformer les constats en actions : une feuille de route pour le changement
Une fois que l’on a fait le constat, que l’on a analysé les données, la question la plus importante demeure : qu’est-ce qu’on fait ? Une étude n’a de valeur que si elle inspire l’action. Chez Diversidays, c’est notre obsession. Nous ne voulons pas seulement être des observateurs, mais des catalyseurs de changement. Les enseignements de notre collaboration avec Google nous offrent une feuille de route claire pour les entreprises, les associations et même les pouvoirs publics qui souhaitent réellement faire avancer la cause de l’inclusion.
Pour les entreprises : oser regarder au-delà du CV parfait
Si je devais donner un conseil à un chef d’entreprise qui nous écoute, ce serait celui-ci : demain matin, changez votre façon de regarder les CV. Remettez en question le filtre quasi automatique du ‘Bac+5’ et du nom de la grande école. En France, et particulièrement dans la tech, ce réflexe est dévastateur.
‘Si on veut être commercial, faut avoir fait HEC. Si on veut être ingénieur dans une start-up en vogue, il faut avoir fait Epitech’.
Le problème, c’est que ces écoles sont elles-mêmes des entonnoirs qui manquent de diversité. À l’époque, Epitech comptait 33 filles sur 500 étudiants. Si vous ne recrutez que dans ce vivier, il est mathématiquement impossible d’atteindre la parité. L’action concrète est donc simple : considérez le profil, essayez de rencontrer la personne. Ne faites pas du diplôme un filtre automatique mais un indicateur parmi d’autres. Aujourd’hui, des formations plus courtes et des parcours de reconversion créent des talents exceptionnels qui n’ont pas un Bac+5 mais possèdent des compétences techniques et une maturité parfois bien supérieures. Donner sa chance à ces profils, c’est non seulement un acte socialement juste, mais aussi une décision business intelligente pour acquérir des talents que vos concurrents ignorent.
Capitaliser sur les moments d’éveil collectif
Un autre enseignement très concret de l’étude est l’impact des journées mondiales. J’étais moi-même sceptique, je me demandais si ces événements, parfois perçus comme symboliques, avaient un réel effet. La réponse des données est sans appel : oui. Les pics de recherche sur des thématiques comme l’homophobie, le handicap ou le racisme coïncident très clairement avec les journées qui leur sont dédiées. Cela signifie que ces moments créent une fenêtre d’attention collective. Pour une entreprise ou une association, c’est une opportunité en or pour sensibiliser, pour diffuser de l’information, pour lancer des initiatives. Plutôt que de communiquer de manière linéaire tout au long de l’année, capitaliser sur ces temps forts permet de toucher un public plus large et plus réceptif. C’est une question de timing stratégique pour maximiser l’impact de ses messages.
Donner du pouvoir (et un budget) aux responsables Diversité
Enfin, une bonne nouvelle est que le métier de responsable diversité et inclusion se développe. La plupart des grandes entreprises du CAC 40 en ont un, et de plus en plus de start-ups s’y mettent. Mais le problème, c’est que ce rôle est souvent un poste sans budget. Or, l’inclusion n’est pas qu’une question de bonne volonté, c’est un investissement. Pour former les salariés, il faut payer des formateurs. Pour organiser une semaine de la diversité et faire venir des intervenants de qualité, comme pour la ‘Fresque de la Diversité’, il faut des moyens. Une direction de la diversité sans budget, c’est comme une direction marketing sans budget publicitaire : elle ne peut pas mener d’actions concrètes. La véritable preuve de l’engagement d’une entreprise se trouve donc là : alloue-t-elle des ressources financières à ses ambitions d’inclusion ? Si la réponse est non, alors le poste risque de n’être qu’une façade. L’inclusion est un effort, et cet effort a un coût qui est en réalité un investissement sur l’avenir.
Conclusion : De la donnée à la décision, le pouvoir est entre nos mains
Au terme de cette exploration, que devons-nous retenir ? Je crois que cette étude est avant tout un formidable message d’espoir. Elle nous montre que, loin du bruit et de la fureur des débats polarisés, la société française est en pleine introspection. Elle se pose des questions, elle cherche à comprendre, elle aspire à plus de justice et de bienveillance. Le passage d’une sémantique de ‘lutte contre’ à une quête de ‘solutions pour’ n’est pas anodin ; c’est le signe d’une maturité collective, d’une volonté de passer du constat à l’action.
Bien sûr, tout n’est pas rose. La persistance de requêtes angoissantes comme ‘suis-je normal ?’ ou la réalité du manque de diversité dans des secteurs clés comme la tech nous rappellent que le chemin est encore long. Mais nous avons désormais des outils pour avancer. Nous savons où se situent les besoins d’information, nous comprenons mieux les freins psychologiques et structurels. Pour les entreprises, le message est clair : l’inclusion n’est pas une option ou un sujet ‘à la mode’. C’est une condition de votre survie et de votre pertinence à long terme. C’est un effort conscient, un investissement qui demande de remettre en question des réflexes profondément ancrés, comme le culte du diplôme ou la recherche de l’efficacité immédiate.
En tant que président de Diversidays, je vois chaque jour des talents incroyables qui ne demandent qu’à être vus. Des entrepreneurs de zones rurales, des femmes issues de quartiers populaires, des personnes en reconversion qui ont une énergie et une créativité folles. Notre rôle est de les rendre visibles. Mais l’effort doit être partagé. Chaque manager, chaque recruteur, chaque dirigeant a le pouvoir, demain matin, de décider d’ouvrir une porte plutôt que de la fermer. L’inclusion, au fond, ce n’est rien d’autre que ça : un effort.
‘Naturellement on va aller vers des personnes qui nous ressemblent. Donc le faire différemment, ça demande des efforts, c’est pas automatique.’
C’est cet effort que je vous invite à faire. Lisez l’étude, interrogez vos pratiques, et agissez. Car ce qui ne se mesure pas n’existe pas, mais ce qui est mesuré et ignoré est une responsabilité que nous ne pouvons plus nous permettre de porter.
Foire aux questions (FAQ)
Pourquoi la diversité dans le secteur de la tech est-elle particulièrement faible en France ?
Le manque de diversité dans la tech française est un paradoxe. Ce secteur tourné vers l’innovation est souvent bloqué par des réflexes conservateurs en matière de recrutement. La raison principale est la culture de l’hyper-croissance et de la ‘performance’ à court terme, qui pousse les entreprises à recruter des profils qui leur ressemblent pour minimiser le temps d’intégration. Ce biais est renforcé par une forte dépendance aux diplômes de quelques grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce, qui ne sont pas elles-mêmes représentatives de la diversité sociale et de genre en France. L’impression d’efficacité immédiate l’emporte sur le bénéfice à long terme de l’innovation apportée par des équipes diverses.
‘Ce qui se passe dans la tech c’est que on est sur des modèles qui sont dans une quête de performance économique rapide. (…) plus on va mettre l’accent sur la question de performance et de mérite, plus on va avoir tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent.’
Quelle a été la découverte la plus surprenante de votre étude sur les recherches Google ?
La découverte la plus marquante et la plus positive est sans doute le glissement sémantique des recherches. Nous sommes passés d’un vocabulaire majoritairement axé sur la ‘lutte contre’ les discriminations à une recherche proactive de solutions et d’actions ‘pour’ l’inclusion. Les internautes cherchent moins à débattre d’un problème qu’à trouver des ressources concrètes : une association locale, des informations sur un statut administratif comme la RQTH, ou des contenus culturels pour s’éduquer. Cela montre une maturité de la société qui passe du stade de la prise de conscience à celui de l’engagement pratique et personnel, ce qui est très encourageant.
‘Le premier constat de l’étude, c’est qu’avant on était plutôt dans un vocabulaire contre, on était plutôt dans la lutte (…). Mais on voit qu’il y a de plus en plus de recherches pour. Donc de recherches qui se dirigent plutôt vers l’action.’
Comment une entreprise peut-elle mesurer concrètement les bénéfices de la diversité ?
Mesurer le retour sur investissement (ROI) de la diversité est complexe car ses bénéfices sont souvent qualitatifs et à long terme. Cependant, des indicateurs existent. Des études, comme celles de l’OCDE, ont montré une corrélation directe entre la diversité des équipes (genre, origine sociale, etc.) et la performance en matière d’innovation et la durabilité de l’entreprise. En interne, on peut mesurer des indicateurs comme un taux de rétention des talents plus élevé, une meilleure satisfaction des employés, et une plus grande créativité dans la résolution de problèmes. Le bénéfice le plus tangible est la capacité à mieux comprendre et servir un marché de clients qui est, par définition, diversifié.
‘Sur l’innovation, on a aussi d’autres études qui nous montrent que pour être plus créatif et pour permettre beaucoup plus d’innovation voire les entreprises dans les start-up qui durent le plus longtemps sont celles qui ont le plus de diversité en terme de genre, d’origine sociale, ethnique et cetera.’
Quel est le premier pas qu’un manager devrait faire pour recruter de manière plus inclusive ?
Le premier pas, le plus simple et le plus impactant, est de consciemment remettre en cause le filtre du ‘Bac+5’ ou de la ‘grande école’. Au lieu de jeter automatiquement les CV qui ne correspondent pas à ce critère, il faut prendre le temps de les lire et de considérer les expériences, les compétences acquises via des reconversions ou des formations alternatives. Le manager doit s’autoriser à rencontrer la personne derrière le CV. Ce changement de réflexe ouvre la porte à un vivier de talents immense et souvent ignoré. C’est une action qui ne coûte rien et qui peut transformer radicalement la composition et la richesse d’une équipe.
‘Lorsque je reçois des CV, déjà je mets pas automatiquement à la poubelle des CV qui ont pas un bac plus 5, j’essaie d’ouvrir mes chakras par rapport à ça. (…) Je considère pas que le bac + 5 est un filtre automatique.’
Les ‘journées mondiales’ dédiées à la diversité ont-elles un impact réel ou sont-elles purement symboliques ?
Notre étude a clairement démontré que les journées mondiales ont un impact très réel et mesurable. Nous avons observé des pics de recherches significatifs sur les thématiques concernées (handicap, homophobie, etc.) durant ces journées spécifiques. Cela prouve qu’elles agissent comme un puissant catalyseur d’attention, incitant le grand public à s’informer et à se sensibiliser. Loin d’être symboliques, elles sont des fenêtres d’opportunité cruciales pour les associations et les entreprises qui souhaitent diffuser leurs messages à un public plus large et plus réceptif. Elles permettent de faire exister ces sujets dans l’espace public et de susciter la curiosité.
‘On se rend compte que oui. Les journées mondiales sur les différentes thématiques (…) ça permet de sensibiliser. Donc ça peut être des bons moments en fait (…) pour donner de la visibilité.’
Comment l’étude reflète-t-elle l’inquiétude croissante pour la santé mentale en France ?
L’étude met en évidence une véritable explosion des recherches liées à la santé mentale, particulièrement depuis la crise du Covid. Nous avons constaté une augmentation massive de requêtes pour des termes comme ‘burnout’ (+40%), ‘antidépresseur’, mais aussi des questions plus existentielles comme ‘suis-je hypersensible ?’. Cela traduit une anxiété collective et un besoin de mettre des mots sur un mal-être. Les Français cherchent à comprendre leurs émotions et leur état psychologique. C’est un signal fort pour les entreprises, qui doivent désormais considérer la santé mentale de leurs salariés comme une priorité stratégique et non plus comme un sujet tabou.
‘Sur la santé mentale, on a une explosion de certains items. Par exemple, on a une explosion de burnout plus 40 % je crois. On a une explosion de d’antidépresseur. (…) Le sujet de la santé mentale il est en train de grossir petit à petit.’
Quel rôle jouent la pop culture et les ‘rôles modèles’ dans l’avancement de l’inclusion ?
La pop culture et les rôles modèles sont des vecteurs d’inclusion extrêmement puissants. Notre étude montre que les internautes associent souvent leurs recherches sur une thématique à des personnalités publiques (sportifs, artistes, politiques). Ces figures permettent de s’identifier et de se projeter. Comme le montre le livre ‘Pop & Psy’ de Jean-Victor Blanc, utiliser des références culturelles connues, comme la dépression de Britney Spears, pour expliquer des concepts de santé mentale les rend plus accessibles et déstigmatise le sujet. Pour se sentir concerné par un enjeu, il est souvent nécessaire de voir des personnes qui nous ressemblent ou nous inspirent l’incarner.
‘Pour se sentir concerné par des sujets, on a souvent besoin d’avoir des personnes qui nous ressemblent ou qui nous inspirent (…). Pour se sentir touché par un personnage, il faut qu’il y ait quand même des points communs avec nous.’
Comment les entreprises et les particuliers peuvent-ils soutenir concrètement des associations comme Diversidays ?
Pour soutenir une association comme la nôtre, il y a deux leviers majeurs. Le premier est financier : nous restons une association et nos programmes d’accompagnement reposent sur les financements d’entreprises partenaires. Engager une discussion pour voir comment collaborer est un excellent point de départ. Le deuxième levier, tout aussi crucial, est de donner une chance concrète aux talents que nous accompagnons. Cela signifie ouvrir ses processus de recrutement à nos candidats en reconversion ou issus de parcours différents, et faire confiance à leurs compétences. Le meilleur moyen de nous aider est de faire en sorte que nos programmes débouchent sur un retour à l’emploi. C’est la finalité de notre action.
‘Le meilleur moyen aussi d’aider l’association, c’est de donner une chance à des personnes qui font une reconversion et il y en a beaucoup dans le numérique qui ont pas forcément bac + 5, mais qui sont excellents.’