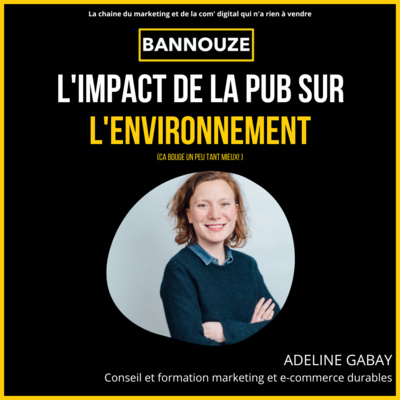L’impact de la publicité sur l’environnement : il est temps de regarder au-delà de l’impression
Imaginez un instant. Vous êtes sur le point de lancer la plus grosse campagne publicitaire de l’année. Le brief est validé, les créations sont prêtes, le plan média est bouclé. Tout semble parfait. Mais avez-vous déjà pensé au coût invisible de cette campagne ? Pas le coût financier, non, mais son poids environnemental. Chaque impression, chaque vidéo vue, chaque clic génère une cascade de conséquences écologiques que nous commençons à peine à mesurer. Ce sujet, longtemps resté dans l’ombre des préoccupations business, émerge aujourd’hui avec une force implacable. Comme je l’explique souvent en tant que consultante, nous, professionnels du marketing et de la publicité, sommes au cœur d’un paradoxe : notre métier est de stimuler la demande, mais nous évoluons dans un monde aux ressources finies. Alors, comment concilier performance et responsabilité ?
La question n’est plus de savoir *si* la publicité a un impact, mais de comprendre *comment* et *où* il se situe pour pouvoir agir. C’est un sujet complexe, souvent obscur, où se mêlent des enjeux techniques, économiques et sociétaux. L’impact de la publicité sur l’environnement ne se résume pas à l’électricité consommée par un serveur. C’est une chaîne de valeur entière, de l’idée créative à l’acte d’achat qu’elle inspire, qui doit être questionnée. Comme je le disais dans le podcast avec Laurent, ‘on pense souvent à l’impact de la diffusion de la publicité en terme de d’émission carbone […] mais avant ça, il faut produire les créations’. Et surtout, il y a l’impact du message lui-même, celui qui façonne nos désirs et nos modes de vie. Dans cet article, nous allons décortiquer ensemble ces différentes facettes, explorer les solutions qui émergent pour mesurer et réduire notre empreinte, et poser les questions, parfois difficiles, sur le rôle de notre industrie dans la transition écologique.
Les trois visages de l’impact environnemental de la publicité
Pour agir efficacement, il faut d’abord comprendre précisément où se situe le problème. L’impact environnemental de la publicité est souvent réduit à sa dimension numérique, c’est-à-dire à l’énergie consommée par sa diffusion. C’est une partie importante de l’équation, mais c’est loin d’être la seule. En réalité, on peut décomposer cet impact en trois niveaux distincts, chacun avec ses propres enjeux et leviers d’action : la production des contenus créatifs, la diffusion technique des campagnes, et enfin, l’influence du message publicitaire sur les comportements de consommation. Ignorer l’un de ces trois piliers, c’est passer à côté de l’essentiel et risquer de concentrer ses efforts au mauvais endroit.
1. La production créative : le coût caché derrière le glamour
Avant même qu’une seule impression ne soit servie, une campagne publicitaire a déjà commencé à laisser son empreinte sur la planète. La phase de production des contenus, notamment pour la vidéo, est extrêmement gourmande en ressources. Pensez à un tournage classique pour un spot télévisé ou une vidéo en ligne. Cela implique souvent des déplacements, parfois à l’autre bout du monde. Comme je l’évoquais, on peut se retrouver à ‘aller faire des tournages en Afrique du Sud ou plus plus proche en France et tout ça bah forcément, c’est des déplacements en avion de plus ou moins grosses équipes de tournage’. À cela s’ajoute toute la logistique sur place : l’hébergement, la restauration (la ‘cantine’), le transport du matériel lourd, la consommation d’énergie pour l’éclairage et les équipements techniques, la construction de décors éphémères qui seront ensuite jetés… L’impact carbone de cette seule phase peut être colossal. Au-delà du carbone, il y a la génération de déchets et la consommation de ressources. L’écoproduction publicitaire cherche à répondre à ces enjeux en proposant des alternatives : privilégier les tournages locaux, utiliser des éclairages LED moins énergivores, optimiser les déplacements, recycler les décors, ou encore, et c’est un levier majeur, réutiliser et adapter des contenus créatifs existants plutôt que de repartir de zéro pour chaque campagne.
2. La diffusion : l’iceberg numérique de la chaîne publicitaire
C’est la partie la plus souvent évoquée, mais aussi la plus complexe techniquement. La diffusion d’une publicité digitale, en particulier en programmatique, est une chaîne longue et complexe qui mobilise une quantité phénoménale d’infrastructures. Pour qu’une bannière s’affiche sur votre écran, il faut ‘des serveurs, il faut du réseau, il faut des terminaux utilisateurs pour diffuser la publicité’. Chaque impression déclenche une série de micro-transactions et d’appels entre de multiples serveurs (ceux de l’éditeur, des SSP, des DSP, des serveurs de mesure, etc.). Chacun de ces allers-retours consomme de l’énergie pour le calcul et pour le transit des données. Plus la chaîne est complexe, avec de nombreux intermédiaires, plus la consommation énergétique augmente. Le poids de la création publicitaire joue aussi un rôle majeur : une vidéo 4K pèse beaucoup plus lourd qu’une bannière statique, ce qui augmente le volume de données à transférer et à stocker. Enfin, l’impact dépend crucialement de la source de l’électricité qui alimente ces data centers. Sont-ils situés dans une région où l’énergie est produite à partir du charbon ou d’énergies renouvelables ? C’est une question que les annonceurs doivent commencer à poser à leurs partenaires technologiques.
3. Le message : l’impact le plus puissant et le plus systémique
C’est sans doute l’impact le plus important, mais aussi le plus difficile à quantifier. C’est ce que j’appelle l’impact du fond. La fonction première de la publicité est de nous faire acheter. La question fondamentale est donc : ‘qu’est-ce que promeut la publicité ? Quel mode de vie, quel mode de consommation elle met en scène et puis quel produits et services elle elle cherche à nous vendre’. Si une campagne, même écoconçue et diffusée de manière optimisée, promeut un SUV très polluant, un produit issu de la fast-fashion ou un smartphone à renouveler tous les ans, son impact final sur l’environnement sera massivement négatif. La publicité est un formidable moteur culturel qui façonne les imaginaires collectifs, les aspirations et les normes sociales. Elle a le pouvoir de rendre désirable un mode de vie basé sur la surconsommation, l’hyper-renouvellement et la possession matérielle. C’est là que réside sa plus grande responsabilité. Inversement, elle possède aussi le pouvoir de promouvoir de nouveaux récits : valoriser la réparation, la seconde main, l’usage plutôt que la possession, ou les services à faible impact. C’est sur ce terrain que se jouera la véritable transformation de notre industrie.
Comprendre cette triple nature de l’impact est la première étape indispensable. Cela permet de réaliser qu’optimiser uniquement la diffusion digitale, bien que nécessaire, ne suffit pas. Une approche holistique est requise, qui questionne à la fois nos manières de produire, nos manières de diffuser et, surtout, nos manières de communiquer. La prochaine étape logique est alors de se demander : comment mesurer tout cela pour pouvoir le piloter ?
Le défi de la mesure : comment quantifier l’empreinte carbone de la publicité ?
Une fois la prise de conscience effectuée sur les différentes sources d’impact, une question pragmatique se pose pour tout annonceur ou agence : comment mesurer notre empreinte pour savoir d’où l’on part et suivre nos progrès ? C’est là que les choses se compliquent. Le marché a vu éclore une multitude d’initiatives et de ‘calculateurs carbone’, mais cette effervescence a aussi créé une grande confusion. Comme je l’ai constaté en travaillant sur ces sujets avec l’écosystème, nous sommes face à un ‘ordre un petit peu dispersé’. Harmoniser les méthodes de calcul est devenu le principal enjeu pour rendre la mesure crédible et actionnable à grande échelle.
L’empreinte environnementale : bien plus que du CO2
Avant de parler de calcul, il est crucial de rappeler une chose : le carbone n’est qu’un indicateur parmi d’autres. Se focaliser uniquement sur les émissions de CO2 est une vision réductrice de l’impact environnemental. Comme je l’ai souligné, ‘il y a pas que que le carbone qui est responsable du bouleversement climatique’. L’empreinte environnementale du numérique et de la publicité inclut également un impact sur la ressource en eau (notamment pour le refroidissement des data centers), un impact sur l’épuisement des ressources non renouvelables (‘il faut des terres rares, des métaux et cetera’ pour fabriquer nos smartphones, ordinateurs et serveurs), ainsi qu’un impact sur la pollution de l’air, des sols et de l’eau. L’analyse du cycle de vie (ACV) est l’approche la plus complète, car elle prend en compte toutes les étapes, de l’extraction des matières premières à la fin de vie des équipements. La plupart des calculateurs actuels se concentrent sur le carbone durant la phase d’usage (la diffusion), mais il est essentiel de garder en tête cette vision plus large pour ne pas tomber dans le piège du ‘carbon tunnel vision’.
Un paysage de la mesure fragmenté et complexe
Aujourd’hui, si un annonceur veut mesurer l’empreinte carbone de ses campagnes, il se retrouve face à un véritable puzzle. De nombreuses sociétés ont développé leurs propres outils, que ce soit des régies, des agences médias ou des entreprises de l’AdTech. Le problème, c’est que ces outils ne reposent pas sur les mêmes bases. Lors de nos travaux avec l’IAB (maintenant Alliance Digitale), nous nous sommes aperçus que ‘tout le monde n’était pas du tout sur le même périmètre, le même la même méthodologie et cetera’. Certains vont mesurer en temps réel, d’autres se baser sur des moyennes. Certains incluent l’impact des terminaux utilisateurs, d’autres non. Certains prennent en compte toute la chaîne programmatique, d’autres seulement une partie. Cette situation pose un problème majeur : il devient impossible de comparer ce qui n’est pas comparable et d’avoir une vision consolidée. C’est l’analogie des ‘choux et des carottes’ : un annonceur ne peut pas additionner les reportings de ses différents partenaires s’ils ne mesurent pas la même chose. Cela empêche d’avoir une vision globale et de prendre des décisions éclairées.
L’effort français de standardisation : vers un référentiel commun
Face à ce constat, l’écosystème publicitaire français, qui est particulièrement en avance sur ces sujets, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. C’est un projet sur lequel je travaille activement avec des instances comme le SRI (Syndicat des Régies Internet) et Alliance Digitale. L’objectif est clair : ‘il faut absolument que on se mette tous sur le même le même standard méthodologique’. L’idée est de créer un référentiel commun, une sorte de grammaire partagée, qui définisse précisément le périmètre à mesurer, les données d’entrée à prendre en compte (volume d’impressions, poids de la créa, complexité de la chaîne d’achat…) et les facteurs d’émission à utiliser pour convertir une activité (comme un appel serveur) en équivalent CO2. Ce travail est fondamental pour apporter de la transparence et de la fiabilité au marché. Il permettra à terme à un annonceur de disposer d’une mesure comparable d’un partenaire à l’autre, et donc de piloter réellement la réduction de son empreinte carbone sur des bases solides. L’Union des Marques soutient également cette démarche en travaillant sur un ‘méta-référentiel’ pour agréger les différentes initiatives.
La route vers une mesure standardisée et complète est encore longue, mais la dynamique est lancée. Pour les annonceurs, même en attendant ce standard, il est déjà possible d’agir. L’absence d’un outil de mesure parfait ne doit pas être une excuse pour l’inaction. Des principes de bon sens et des actions concrètes peuvent être mis en place dès aujourd’hui pour réduire significativement l’impact de ses campagnes.
Le guide pratique de l’annonceur responsable : 3 leviers pour agir maintenant
L’ampleur du sujet peut sembler paralysante. Face à la complexité de la mesure et aux enjeux systémiques, beaucoup d’annonceurs se demandent : ‘Par où commencer ? Quelles actions concrètes puis-je mettre en place dès demain ?’. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe de nombreux leviers activables rapidement. Fait intéressant, la plupart de ces actions rejoignent les bonnes pratiques d’un marketing digital performant et efficace. La sobriété environnementale et l’efficacité business vont souvent de pair. Il ne s’agit pas de tout arrêter, mais de faire mieux avec moins, en se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité.
1. Déclarer la guerre au gâchis publicitaire
Le premier gisement d’optimisation, le plus évident et le plus rentable, est la lutte contre le gaspillage. Le marketing digital, par sa nature, génère énormément de ‘déchets’ : des impressions publicitaires qui ne sont jamais vues, des clics frauduleux générés par des robots, des campagnes qui ciblent des personnes déjà convaincues… Chaque impression inutile est une consommation de ressources et d’énergie à blanc. La première étape est donc de ‘limiter le gâchi publicitaire parce que on sait que dans le marketing digital, il y en a beaucoup’. Concrètement, cela signifie :
- Travailler sur la visibilité : Assurez-vous que vos publicités sont réellement vues par des humains. Piloter ses achats sur des CPM visibles plutôt que des CPM servis est un premier pas essentiel.
- Lutter contre la fraude : Utilisez des outils de détection de la fraude pour éviter de payer pour du trafic invalide, qui non seulement grève votre budget mais consomme aussi de l’énergie inutilement.
- Rationaliser le ciblage : Évitez la surpression publicitaire et le retargeting à outrance. Comme je l’expliquais, si vous mettez ‘la moitié de ton budget en retargeting pour en fait convaincre des clients qui seraient de toute façon venus chez toi’, vous générez des impressions superflues. Une meilleure compréhension du parcours client et une attribution plus fine permettent d’éviter ce gaspillage.
En somme, il s’agit d’appliquer du bon sens et de se concentrer sur ce qui crée réellement de la valeur.
2. Rationaliser sa stack technologique et ses achats
La complexité est l’ennemie de la sobriété. L’écosystème de la publicité digitale a vu une prolifération d’outils et d’intermédiaires. Or, chaque partenaire technologique dans votre chaîne d’achat ajoute des appels serveurs, des synchronisations de cookies et donc une consommation d’énergie. Comme je le disais, ‘on a eu tendance à multiplier les les outils qui font la même chose. Et c’est un peu une débauche énergétique aussi’. Il est donc primordial de faire un audit de sa ‘stack’ technique : Avez-vous réellement besoin de trois outils de mesure différents ? Votre chaîne d’achat en programmatique est-elle la plus directe possible ? Simplifier et rationaliser ses partenaires n’est pas seulement bon pour l’environnement, c’est aussi souvent bénéfique pour la transparence et les coûts.
Au-delà des outils, il faut questionner les partenaires eux-mêmes sur leur politique environnementale. ‘Travailler avec ses partenaires pour savoir justement comment eux abordent le sujet de leur responsabilité sociale et environnementale’ est une démarche clé. Demandez à vos agences, à vos régies, mais aussi aux géants comme Google ou Amazon : Où sont hébergées mes données ? Quelle est la source d’énergie de vos data centers ? Quels sont vos engagements pour réduire votre propre empreinte ? En tant que client, l’annonceur a un pouvoir d’influence considérable pour faire bouger l’ensemble de l’écosystème.
3. Miser sur la qualité et l’écoconception des contenus
Enfin, l’action doit porter sur le contenu lui-même. Privilégier la qualité à la quantité est une règle d’or. Plutôt que de multiplier les campagnes éphémères, il est plus pertinent de créer des contenus durables et à forte valeur ajoutée. Sur le plan technique, l’écoconception des créations publicitaires est un levier puissant. Le poids d’une créa est un facteur déterminant de son empreinte carbone lors de la diffusion. Il faut donc travailler avec les agences créatives pour optimiser les formats : compresser les images et les vidéos, éviter les scripts trop lourds, privilégier les formats vectoriels quand c’est possible…
Et comme nous l’avons vu, il faut aussi réfléchir à l’impact de la production. Le premier conseil que je donne souvent est de se demander : ‘Est-ce que je fais un tournage spécifique pour de la vidéo ou est-ce que j’essaie de recycler un peu du du matériel créatif qui existe déjà ?’. Utiliser des banques d’images, des animations ou réadapter des films existants sont des alternatives beaucoup plus sobres que de lancer une production complète à chaque fois. Lorsque le tournage est inévitable, l’adoption d’un cahier des charges d’écoproduction permet de limiter drastiquement son impact.
Ces trois leviers démontrent qu’il est possible d’agir sans attendre une révolution. En intégrant ces réflexes dans les processus de décision marketing, les annonceurs peuvent non seulement réduire leur empreinte environnementale, mais aussi souvent améliorer leur efficacité publicitaire. Cependant, ces optimisations, aussi nécessaires soient-elles, nous amènent inévitablement à une question plus profonde : suffiront-elles à résoudre la contradiction fondamentale entre la publicité et la sobriété ?
Le dilemme final : la publicité peut-elle être une alliée de la transition écologique ?
Après avoir exploré les impacts, les méthodes de mesure et les leviers d’optimisation, nous arrivons au cœur du réacteur, à la question qui fâche. Imaginons un monde idéal où, d’ici quelques années, tous les annonceurs appliquent scrupuleusement les bonnes pratiques : campagnes optimisées, productions bas carbone, diffusion sobre… Aurons-nous pour autant réglé le problème ? Pas entièrement. Car si la forme a changé, le fond, lui, reste le même : la publicité, dans son essence, est conçue pour stimuler la consommation. Et c’est ce modèle global qu’il faut oser interroger.
La confrontation avec le modèle de la croissance infinie
Le véritable enjeu est là. Comme je le souligne, on arrive très vite à ‘questionner le le modèle d’affaires des entreprises finalement parce que la publicité est là pour toujours faire vendre plus de produits’. C’est une simple équation : si vous vendez toujours plus de produits, même si chaque produit est un peu plus ‘vert’ et chaque publicité un peu plus ‘sobre’, l’impact global continue d’augmenter à cause de l’effet volume. C’est la fameuse course en avant de la croissance. La publicité est le carburant de ce système. Elle est pointée du doigt, et à juste titre, comme étant ‘un vecteur de la surconsommation qui est un des mots qui nous qui nous mène aujourd’hui dans la la panade dans laquelle on est’. La véritable transition écologique implique de sortir de cette logique du ‘toujours plus’ pour aller vers des modèles économiques différents, comme l’économie de la fonctionnalité, l’économie circulaire ou tout simplement une forme de sobriété choisie. La publicité peut-elle s’adapter à ces nouveaux modèles, voire les promouvoir ? C’est le défi majeur de la prochaine décennie.
L’arme à double tranchant : le pouvoir de changer les comportements
Cependant, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Si la publicité a le pouvoir de promouvoir la surconsommation, elle a aussi un pouvoir inverse. C’est un ‘levier hyper puissant pour faire changer les gens de comportement’. Les défenseurs de l’industrie, et j’en fais partie sur cet aspect, argumentent que la publicité a un rôle crucial à jouer dans la transition. Elle peut rendre désirables de nouveaux comportements plus durables : manger moins de viande, privilégier les transports en commun, réparer ses objets, s’isoler thermiquement… Les compétences des publicitaires en matière de psychologie du consommateur, de créativité et de narration sont des atouts précieux pour accélérer ces changements culturels. La question est de savoir qui financera ces ‘publicités de la transition’ et comment s’assurer qu’elles ne servent pas simplement de caution verte (‘greenwashing’) à des entreprises dont le cœur de métier reste climaticide.
Le financement des médias : le nœud gordien
Enfin, il y a une réalité économique que les critiques les plus radicales de la publicité oublient souvent. Comme nous l’avons rappelé, la publicité ‘permet de financer en fait le contenu gratuit’ sur le web et au-delà. Elle finance une grande partie de l’information, y compris l’information indépendante. Supprimer la publicité du jour au lendemain, comme le prônent certains, aurait des conséquences sociales et démocratiques considérables. Cela nous mènerait vers ‘un modèle premium avec un truc un peu inégalitaire parce que seules les plus riches auraient accès au au contenu de qualité’. C’est un véritable dilemme : comment préserver l’accès gratuit et démocratique à l’information et à la culture, tout en réduisant l’incitation à la surconsommation ? C’est une question de société complexe qui dépasse le seul cadre de notre industrie. Des modèles alternatifs sont à inventer, peut-être autour d’une publicité plus ciblée, plus utile, moins intrusive, et qui financerait en priorité des médias de qualité.
Conclusion : l’optimisme de la volonté
Alors, faut-il être optimiste ou pessimiste ? Pour ma part, je suis d’un naturel optimiste, surtout quand je vois la prise de conscience à l’œuvre. Partout dans les entreprises, ‘tu as plein d’individus un peu partout qui sont vachement préoccupés par ces sujets et qui font bouger les choses’. Cette dynamique interne est le moteur le plus puissant du changement. Le cadre réglementaire, notamment sur le greenwashing, se durcit également et pousse les entreprises à plus de rigueur. La remise en cause des modèles d’affaires est certes plus lente, on n’y est pas encore. Mais la première étape est de poser les bonnes questions. Le rôle des professionnels du marketing et de la publicité est immense. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons continuer à être les agents d’un système à bout de souffle ou devenir les architectes d’un nouveau récit, d’un imaginaire désirable et compatible avec les limites de notre planète. Le chemin est long, mais il est passionnant. Et il commence aujourd’hui, dans chaque brief, chaque recommandation média, chaque choix créatif.
Foire aux Questions (FAQ)
1. Quels sont les trois principaux impacts de la publicité sur l’environnement ?
L’impact environnemental de la publicité se décompose en trois niveaux majeurs. D’abord, la production des contenus créatifs (tournages, déplacements, matériel), qui consomme beaucoup de ressources avant même la diffusion. Ensuite, la diffusion elle-même, en particulier pour le digital, qui repose sur une infrastructure énergivore de serveurs, réseaux et terminaux. Enfin, et c’est le plus important, l’impact du message, qui promeut des modes de vie et de consommation plus ou moins durables. C’est ce dernier point qui a le plus de conséquences systémiques sur l’environnement.
‘En fait, il y a à peu près un peu trois niveaux […]. On pense souvent à l’impact de la diffusion […]. Mais avant ça, il faut produire les créations […]. Et puis surtout en fait, l’impact de la publicité bah c’est l’impact du du du du message, du fond.’
2. Pourquoi est-il si difficile de calculer l’empreinte carbone d’une campagne publicitaire digitale ?
Le calcul est complexe car de nombreux acteurs (régies, agences, adtechs) ont développé leurs propres outils avec des méthodologies et des périmètres différents. Il n’existe pas encore de standard unifié sur le marché. Cela rend les résultats difficiles à comparer et à consolider pour un annonceur qui travaille avec plusieurs partenaires. On ne mesure pas toujours la même chose : certains incluent toute la chaîne programmatique, d’autres non ; certains se basent sur des moyennes, d’autres sur du temps réel. C’est pourquoi des initiatives sont en cours en France pour créer un référentiel méthodologique commun.
‘On s’est aperçu qu’il y avait plein d’initiatives mais que tout le monde était un peu dans le brouillard et surtout tout le monde n’était pas du tout sur le même périmètre, le même la même méthodologie et cetera, ce qui pose un peu des problèmes.’
3. Quelles sont les premières actions concrètes qu’un annonceur peut mettre en place pour réduire son impact ?
Un annonceur peut commencer par des actions de bon sens. Premièrement, optimiser la production créative en favorisant le recyclage de contenus existants plutôt que des tournages systématiques. Deuxièmement, travailler sur la sobriété de la diffusion en luttant contre le gâchis publicitaire (fraude, impressions non vues). Troisièmement, rationaliser ses outils et challenger ses partenaires (agences, régies, hébergeurs) sur leurs propres engagements environnementaux. Il s’agit avant tout de viser la qualité et l’efficacité plutôt que le volume à tout prix.
‘Le premier truc, ça va être d’essayer de d’être sobre et de limiter le gâchi publicitaire parce que on sait que dans le marketing digital, il y en a beaucoup. Donc vraiment travailler sur tous les aspects fraude, visibilité, essayer de rationaliser le le stack technique.’
4. En quoi la lutte contre le gâchis publicitaire est-elle une démarche écologique ?
La lutte contre le gâchis publicitaire (fraude, impressions non vues, surpression publicitaire) est une démarche écologique directe car chaque impression inutile représente une consommation d’énergie et de ressources à blanc. Un clic frauduleux par un robot, une bannière affichée en bas d’une page que personne ne voit, ou une campagne de retargeting qui cible un client déjà convaincu sont autant d’appels serveurs, de calculs et de transferts de données qui ont un coût environnemental pour un bénéfice marketing nul. Réduire ce gâchis, c’est donc simultanément améliorer sa performance business et réduire son empreinte carbone.
‘Si tu comprends pas bien quelle est la contribution de ta publicité à tes ventes, bah tu vas probablement faire du du gâchis […]. Et donc tout ça, c’est en fait des ressources de calcul, des des impressions qui sont diffusées à blanc.’
5. Le greenwashing est-il désormais sanctionné par la loi en France ?
Oui, le cadre légal s’est considérablement durci. Le greenwashing, ou écoblanchiment, est désormais explicitement reconnu comme un délit dans la loi française, assimilé à une pratique commerciale trompeuse. Les entreprises ne peuvent plus utiliser des allégations environnementales vagues ou non prouvées comme ‘neutre en carbone’ ou ‘bon pour la planète’ sans pouvoir le justifier de manière précise. De plus, la loi interdit de promouvoir des comportements contraires au développement durable, comme l’incitation au renouvellement d’un produit qui fonctionne encore. Les autorités comme l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) sont très vigilantes sur ce sujet.
‘Il faut savoir que le green washing maintenant, c’est c’est précisé comme un un délit dans la loi […]. On ne peut plus raconter ce qu’on veut quand on dit que son produit est neutre en carbone, qu’il est meilleur pour la planète.’
6. La publicité est-elle condamnée à disparaître dans un monde durable ?
Ce n’est pas si simple. D’un côté, la publicité alimente un modèle de surconsommation qui n’est pas durable. D’un autre côté, elle est un levier puissant pour faire évoluer les comportements vers plus de durabilité et elle finance une grande partie des contenus gratuits, notamment l’information. La supprimer totalement poserait un problème d’accès à l’information pour ceux qui ne peuvent pas payer d’abonnements. L’avenir réside probablement dans une transformation profonde de la publicité pour qu’elle promeuve des modèles économiques plus vertueux (réparation, usage, circularité) et qu’elle finance des médias de qualité de manière plus responsable.
‘La pub bah ça finance tous nos usages gratuits sur le sur le web et ça finance l’information indépendante aussi. sinon on serait dans un modèle premium avec un truc un peu inégalitaire parce que seules les plus riches auraient accès au au contenu de qualité.’
7. Comment les choix technologiques (programmatique, stack technique) influencent-ils l’impact environnemental ?
Les choix technologiques ont un impact direct. Une chaîne d’achat en programmatique avec de nombreux intermédiaires (SSP, DSP, outils de mesure, etc.) génère beaucoup plus d’appels serveurs qu’un achat en gré à gré (direct éditeur). Chaque intermédiaire ajoute de la complexité et donc de la consommation énergétique. De même, multiplier les outils marketing qui font des choses similaires dans sa ‘stack’ technique conduit à une ‘débauche énergétique’. Rationaliser ses partenaires technologiques et privilégier les chaînes les plus courtes et efficaces sont des leviers importants pour réduire l’empreinte carbone de la diffusion publicitaire.
‘Évidemment, plus tu as de complexité technologique dans la chaîne et d’intermédiaire, plus ça fait appel à des nombreux serveurs dans tous les sens, des ressources de calculs de tous ces serveurs qui que tu tu tu vas convertir en en énergie en fait.’
8. Où trouver des informations fiables sur l’impact environnemental du numérique ?
Pour des informations sourcées et officielles en France, il est recommandé de consulter les travaux d’institutions publiques. L’ADEME (Agence de la transition écologique) et l’Arcep (le régulateur des télécoms) publient régulièrement des études et des chiffres de référence sur le sujet. Les rapports parlementaires, comme ceux du Sénat, sont également des sources très riches et documentées. Il faut rester critique face aux nombreux chiffres qui circulent dans les médias et toujours se demander quel est le périmètre de l’étude et la méthodologie utilisée, notamment si elle suit les principes de l’analyse du cycle de vie.
‘Tu peux aller consulter les chiffres de l’ADEME, de l’Arcep, les rapports du Sénat sur le sujet. Enfin il y a des choses maintenant qui sont voilà qu’on qu’on peut plus remettre en question parce que ça a été publié de façon de façon officielle.’