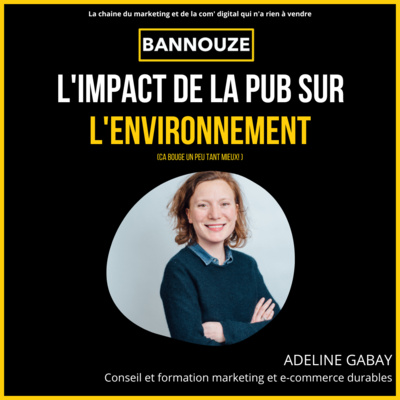L’impact de la publicité sur l’environnement : au-delà de l’empreinte carbone
Bonjour Adeline. Bonjour Laurent. Écoute, merci pour ta participation dans ce deuxième épisode avec toi. Aujourd’hui, on va parler de l’impact de la publicité sur l’environnement. C’est un sujet vaste et complexe. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous éclairer sur ce que signifie réellement cet impact ?
Adeline Gabet se présente : « Je m’appelle Adeline Gabet. Aujourd’hui, je suis consultante et formatrice à mon compte, en indépendante, sur tous les sujets justement liés à la transition écologique des métiers du marketing digital et de l’e-commerce. Et avant ça, j’ai une longue carrière dans le domaine du marketing digital, notamment chez Publicis Media où j’étais en charge du programmatique. »
Mais alors, que recouvre précisément cette notion d’impact environnemental de la publicité ? Adeline explique qu’il y a « un peu trois niveaux » à considérer. C’est une vision bien plus large que celle à laquelle on pense spontanément.
La production des contenus : le premier impact invisible
Le premier niveau d’impact, souvent sous-estimé, est celui de la production créative. « Avant la diffusion, il faut produire les créations, il faut produire les films publicitaires, il faut aller faire des tournages en Afrique du Sud ou plus proche en France », précise Adeline. Cette phase est loin d’être neutre. Elle implique des déplacements, parfois en avion, pour des équipes plus ou moins grandes, de la logistique, du matériel, de la restauration… « Tout ça, bah forcément, c’est des déplacements […] c’est de la cantine, c’est du matériel et cetera. Donc ça aussi ça a un impact sur l’environnement, notamment un impact en terme carbone. » Cette première étape de la chaîne publicitaire constitue donc un pôle d’émissions significatif avant même qu’une seule impression ne soit servie.
La diffusion de la publicité : l’empreinte carbone du digital
Le deuxième niveau est celui auquel on pense le plus souvent : la diffusion. C’est particulièrement vrai pour la publicité digitale. « Pour la publicité digitale par exemple, il faut des serveurs, il faut du réseau, il faut des terminaux utilisateurs pour diffuser la publicité », rappelle Adeline. L’ensemble de cette infrastructure numérique est extrêmement énergivore. « Donc ça, ça consomme de l’énergie et des ressources. » Chaque bannière, chaque vidéo pré-roll diffusée déclenche une cascade de requêtes entre serveurs, data centers et terminaux, générant une consommation d’électricité et, par conséquent, un impact environnemental de la publicité direct et mesurable.
Le message publicitaire : l’impact sur les modes de consommation
Enfin, le troisième niveau est sans doute le plus important et le plus profond. C’est celui du message, du fond. « C’est-à-dire qu’est-ce que promeut la publicité, quel mode de vie, quel mode de consommation elle met en scène et puis quel produit et service elle cherche à nous vendre. » C’est ici que l’enjeu devient sociétal. Comme le souligne Adeline, « si ces produits et ces services ont un impact même très néfaste sur l’environnement, et ben c’est là finalement où on va avoir le plus d’impact de cette publicité. » La publicité n’est pas qu’un simple canal de diffusion ; elle est un puissant moteur culturel qui façonne nos désirs et encourage des comportements. C’est là que réside son principal levier, pour le meilleur comme pour le pire, sur la transition écologique.
Mesurer l’empreinte de la publicité : un chantier complexe mais nécessaire
On voit beaucoup d’entreprises qui essaient de calculer l’impact carbone de la publicité, mais cela semble souvent très obscur. Comment s’y retrouver dans cette jungle de calculateurs et de méthodologies ? Adeline confirme que « c’est un sujet qui est pas évident ».
Il est important de noter que l’empreinte n’est pas uniquement liée au carbone. « L’empreinte environnementale de la pub, de la pub digitale, c’est aussi un impact sur la ressource en eau, ça a un impact sur la consommation de ressources non renouvelables parce que pour construire tous nos terminaux numériques, il faut excaver beaucoup de matières du sol, il faut des terres rares, des métaux et cetera. » La pollution de l’air, du sol et de l’eau est également une conséquence directe de cette industrie. La prise de conscience de ces enjeux a cependant été fulgurante ces dernières années.
La prise de conscience post-Convention Citoyenne pour le Climat
Selon Adeline, le vrai déclic est venu de la Convention Citoyenne pour le Climat. « Là justement, il y a eu un peu un doigt pointé sur l’industrie de la publicité. Et donc tout l’écosystème s’est dit ‘ouh là là, il faut qu’on fasse quelque chose’. » Cette pression a poussé toute l’industrie à se mobiliser, à la fois sur le fond (le message) et sur la forme (la diffusion). La France, sur ce point, fait figure de pionnière : « Il faut vraiment saluer l’écosystème français parce qu’on est super en avance en fait par rapport aux autres pays et ça c’est c’est vraiment chouette. »
La dispersion des initiatives de mesure
Cette prise de conscience a entraîné une multiplication des initiatives, notamment la création de calculateurs carbone pour les régies, les agences et les adtechs. Cependant, cette effervescence s’est faite en ordre dispersé. « Finalement tout ça est allé en ordre un petit peu dispersé », constate Adeline, qui fait un parallèle avec les débuts de la brand safety ou de la mesure de visibilité. Pour y voir plus clair, un travail d’état des lieux a été mené avec l’IAB (maintenant Alliance Digitale). Le constat fut sans appel : « On s’est aperçu qu’il y avait plein d’initiatives mais que tout le monde était un peu dans le brouillard et surtout tout le monde n’était pas du tout sur le même périmètre, la même méthodologie et cetera. » Cette hétérogénéité pose un problème majeur : comment un annonceur peut-il avoir une vision globale s’il doit « additionner des choux et des carottes » ? Il est donc impératif de se mettre d’accord sur un standard commun. C’est la mission sur laquelle travaille Adeline avec le SRI et Alliance Digitale : « créer un référentiel, on espère unique, qui soit adopté par le maximum de gens pour mesurer justement l’empreinte carbone des pubs digitales. »
Comment fonctionnent les calculateurs d’empreinte carbone ?
Techniquement, comment ces outils fonctionnent-ils ? Adeline explique qu’il existe deux approches : « Tu en as qui font des mesures en temps réel et d’autres qui vont fonctionner, on va dire sur des moyennes. » Plusieurs paramètres sont pris en compte. Les plus importants sont :
- Le volume d’impressions : la base de tout calcul.
- Le poids de la création : « ça va déterminer un volume de données qui transitent par les réseaux et qui est stocké par les data centers. » Une vidéo lourde aura un impact bien plus grand qu’une bannière statique légère.
- La complexité de la chaîne de diffusion : « Est-ce que tu diffuses en programmatique ou en gré à gré ? Évidemment plus tu as de complexité technologique dans la chaîne et d’intermédiaires, plus ça fait appel à de nombreux serveurs dans tous les sens. » Chaque intermédiaire ajoute une couche de consommation énergétique.
Le rôle clé des annonceurs : de l’obligation à l’action
Face à cet enjeu, quel est le rôle de l’annonceur ? Doit-il être le moteur du changement ? Pour les plus grosses entreprises, la question ne se pose plus. « Les annonceurs aujourd’hui, notamment les gros, ils sont tous obligés de faire leur bilan carbone », explique Adeline. Une nouvelle obligation réglementaire renforce encore leur responsabilité : « Depuis le 1er janvier, ils vont être obligés d’inclure le scope 3 de leurs émissions, c’est-à-dire en fait toutes les émissions indirectes qui sont liés à tous leurs partenaires, leurs achats. » La publicité fait partie intégrante de ce Scope 3. Jusqu’à présent, les méthodes de calcul étaient très approximatives, se basant sur des facteurs monétaires. L’enjeu est donc de passer à des mesures plus précises, d’où l’importance d’un référentiel harmonisé sur lequel travaille notamment l’Union des Marques.
Trois conseils pour une publicité digitale plus responsable
Si Adeline Gabet devait donner trois conseils concrets aux annonceurs, quels seraient-ils ?
- Repenser la production de contenu : « La première chose, c’est déjà la production du contenu. Est-ce que je fais un tournage spécifique pour de la vidéo ou est-ce que j’essaie de recycler un peu du matériel créatif qui existe déjà ? » L’écoconception des créations publicitaires est un premier levier puissant et souvent négligé.
- Choisir ses médias et lutter contre le gâchi : Il ne s’agit pas d’opposer les médias entre eux, mais de viser la sobriété et l’efficacité. « Le premier truc, ça va être d’essayer d’être sobre et de limiter le gâchi publicitaire parce qu’on sait que dans le marketing digital, il y en a beaucoup. » Cela passe par un travail sur la fraude, la visibilité, mais aussi par la rationalisation du stack technique. « On a eu tendance à multiplier les outils qui font la même chose. Et c’est un peu une débauche énergétique aussi. »
- Challenger ses partenaires et sa politique d’achat : Un annonceur a le pouvoir d’influencer toute sa chaîne de valeur. « Travailler avec ses partenaires pour savoir justement comment eux abordent le sujet de leur responsabilité sociale et environnementale. » Cela inclut les géants comme Google ou Amazon. « Qu’est-ce qu’ils font, où est-ce que tes données sont hébergées ? Est-ce que là où elles sont hébergées, on utilise de l’électricité qui provient du charbon de Pologne ou est-ce que c’est du nucléaire ou du renouvelable ? »
Finalement, ces conseils rejoignent souvent le bon sens et les bonnes pratiques du marketing. « C’est là où c’est intéressant parce qu’on rejoint un peu les bonnes pratiques sur le marketing digital en général », analyse Adeline. Mal définir ses KPIs, c’est risquer de faire du gâchi. Par exemple, sur-investir en retargeting pour convaincre des clients déjà acquis, c’est diffuser des « impressions à blanc » qui consomment inutilement des ressources. Le sujet écologique et le sujet business convergent : il est crucial de « savoir ce qu’on fait lorsqu’on lance une campagne digitale. »
Publicité et surconsommation : faut-il changer le modèle ?
Optimiser les campagnes est une première étape indispensable. Adeline estime qu’il y a « tellement de gras à éliminer déjà qu’on peut travailler là-dessus ». Mais une fois ce travail fait, on se heurte à une question plus fondamentale. Si l’on optimise des campagnes qui, in fine, visent à vendre toujours plus, ne fait-on que repousser le problème ?
« On va très vite tomber sur des sujets politiques, de société », reconnaît Laurent. La question est inévitable : l’impact environnemental de la publicité n’est-il pas intrinsèquement lié au modèle de croissance infinie qu’elle soutient ?
Le dilemme de la croissance
Adeline Gabet va droit au but : « Effectivement, tu arrives très vite à questionner le modèle d’affaires des entreprises finalement, parce que la publicité est là pour toujours faire vendre plus de produits. Si tu vends toujours plus de produits, tu rentres dans un cercle où tu émets de plus en plus, quoi qu’il arrive, tes émissions, même si tu as optimisé au max. » La publicité est souvent pointée du doigt, et à raison, comme un « vecteur de la surconsommation ».
Cependant, elle possède aussi un formidable potentiel de transformation. « C’est aussi un levier hyper puissant pour faire changer les gens de comportement », nuancent ses défenseurs. La publicité pourrait donc jouer un rôle majeur dans la transition écologique. Mais qui financera ces campagnes vertueuses ? Et que faire des annonceurs dont le modèle économique est, par nature, peu durable ?
Le financement des médias, l’autre facette du problème
Les critiques les plus virulentes appellent à une interdiction pure et simple de la publicité. Mais ils oublient souvent une de ses fonctions sociales essentielles. « Le souci, c’est que effectivement, ils oublient l’autre pan. Le fait que la pub, bah ça finance tous nos usages gratuits sur le web et ça finance l’information indépendante aussi. » Sans publicité, le modèle économique de nombreux médias et services en ligne s’effondrerait, menant à un « modèle premium avec un truc un peu inégalitaire parce que seuls les plus riches auraient accès au contenu de qualité. » Le débat est donc loin d’être simple.
S’informer, agir et rester optimiste
Pour naviguer dans ce sujet complexe, il est essentiel de s’appuyer sur des sources fiables. Adeline recommande de consulter les travaux de l’ADEM, de l’Arcep ou les rapports du Sénat. Il faut aussi garder un esprit critique face à la multitude de chiffres qui circulent, en s’interrogeant sur la méthodologie utilisée, notamment sur le périmètre de l’analyse du cycle de vie.
Elle partage également des ressources précieuses pour aiguiser son œil critique : le blog du chercheur Gauthier Roussilhe, le podcast « L’Octet Vert » de Tristan Nitot, ou encore « Déclics Responsables » de Perrine Tanguy.
La lutte contre le greenwashing, un combat légal
Le sujet étant une préoccupation majeure, les marques se sentent obligées de communiquer sur leurs engagements, parfois « un peu à tort et à travers », ce qui mène au greenwashing. Adeline invite à consulter les recommandations de l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) sur le sujet. Surtout, elle rappelle que la loi a évolué : « Le greenwashing maintenant, c’est précisé comme un délit dans la loi. » On ne peut plus dire impunément que son produit est « neutre en carbone » ou « meilleur pour la planète ». Il est même interdit de promouvoir des comportements contraires au développement durable, comme inciter à remplacer un produit fonctionnel par un neuf.
Alors, faut-il être optimiste ? « Moi, je suis optimiste sur le sujet de la prise de conscience », affirme Adeline. Elle observe que le changement est souvent porté par des individus au sein des entreprises. Cependant, elle reste plus mesurée sur l’intégration de ces enjeux au plus haut niveau stratégique : « On n’y est pas encore tout à fait. » La remise en cause profonde des business models reste le grand défi à venir.
Pour suivre le travail d’Adeline Gabet, rendez-vous sur LinkedIn et surveillez les prochaines publications d’Alliance Digitale et du collectif Marketing Digital Responsable, qui préparent des référentiels de bonnes pratiques.
FAQ sur l’impact environnemental de la publicité
Quelles sont les trois principales sources d’impact environnemental de la publicité ?
L’impact environnemental de la publicité se décompose en trois niveaux principaux. D’abord, la production des contenus créatifs (tournages, déplacements). Ensuite, la diffusion technique des campagnes, très énergivore dans le digital (serveurs, réseaux). Enfin, et c’est le plus important, l’impact du message qui promeut des modes de consommation et des produits plus ou moins durables.
« Il y a un peu trois niveaux […] la production des créations […] l’impact de la diffusion de la publicité en terme d’émission de carbone […] et puis surtout l’impact du message, du fond. C’est-à-dire qu’est-ce que promeut la publicité. » – Adeline Gabet
Comment calculer l’empreinte carbone d’une campagne publicitaire digitale ?
Le calcul de l’empreinte carbone est complexe et se base sur plusieurs paramètres. Les principaux sont le volume d’impressions, le poids de la création (qui détermine le volume de données transférées), et la complexité de la chaîne de diffusion (le programmatique avec de nombreux intermédiaires étant plus impactant que le gré à gré).
« Grosso modo, les paramètres d’entrée, ça va être bah évidemment ton volume d’impression, mais ça va dépendre beaucoup du poids de la création […] Après, ça va dépendre aussi de […] est-ce que tu diffuses en programmatique ou en gré à gré ? » – Adeline Gabet
Pourquoi est-il si difficile de mesurer l’impact carbone de la pub digitale ?
La difficulté vient du manque d’un standard commun. De nombreuses initiatives de mesure ont vu le jour, mais elles fonctionnent en ordre dispersé, avec des périmètres et des méthodologies différents. Cela rend la consolidation des données très compliquée pour un annonceur qui veut une vision globale de son impact.
« On s’est aperçu qu’il y avait plein d’initiatives mais que tout le monde n’était pas du tout sur le même périmètre, la même méthodologie et cetera. Ce qui pose un peu des problèmes. » – Adeline Gabet
Qu’est-ce que le scope 3 et pourquoi est-il important pour les annonceurs ?
Le scope 3 du bilan carbone d’une entreprise représente toutes ses émissions indirectes, c’est-à-dire celles qui ne proviennent pas directement de ses propres activités mais de sa chaîne de valeur (fournisseurs, partenaires, utilisation des produits). La publicité fait partie de ce scope 3, et les grandes entreprises ont désormais l’obligation légale de l’intégrer dans leur bilan.
« Depuis le 1er janvier, ils vont être obligés d’inclure le scope 3 de leurs émissions, c’est-à-dire en fait toutes les émissions indirectes qui sont liés à tous leurs partenaires, leurs achats […] La publicité fait partie de ce truc là. » – Adeline Gabet
Comment un annonceur peut-il réduire concrètement son empreinte publicitaire ?
Un annonceur peut agir sur trois leviers principaux : l’écoconception de ses contenus (recycler plutôt que produire), la sobriété dans le choix des médias et la lutte contre le gâchi publicitaire (fraude, visibilité, surdiffusion), et enfin, une politique d’achat responsable en challengeant ses partenaires (agences, régies, adtechs) sur leurs propres engagements RSE.
« Première chose, c’est déjà la production du contenu […] la deuxième chose, c’est de réfléchir à ses médias […] d’être sobre et de limiter le gâchi publicitaire […] on peut aussi travailler avec ses partenaires pour savoir justement comment eux abordent le sujet. » – Adeline Gabet
Le greenwashing est-il illégal en France ?
Oui, le greenwashing, ou écoblanchiment, est non seulement considéré comme une pratique commerciale trompeuse, mais le « délit de greenwashing » a été spécifiquement précisé dans la loi française. Il est donc illégal de faire des allégations environnementales fausses ou non prouvées (ex: « neutre en carbone ») ou de promouvoir des comportements contraires au développement durable.
« Il faut savoir que le greenwashing maintenant, c’est précisé comme un délit dans la loi […] on peut plus raconter ce qu’on veut quand on dit que son produit est neutre en carbone, qu’il est meilleur pour la planète. » – Adeline Gabet
Quel est le lien entre le gâchi publicitaire et l’impact environnemental ?
Le gâchi publicitaire (impressions non vues, fraude, ciblage inefficace, surdiffusion) a un impact environnemental direct. Chaque impression inutile consomme de l’énergie pour rien. Mieux piloter ses campagnes avec des KPIs pertinents pour éviter de diffuser des publicités « à blanc », c’est donc à la fois un gain de performance business et une réduction de son empreinte écologique.
« Si tu comprends pas bien quelle est la contribution de ta publicité à tes ventes, bah tu vas probablement faire du gâchi […] tout ça, c’est en fait des ressources de calcul des impressions qui sont diffusées à blanc. » – Adeline Gabet
La suppression de la publicité est-elle une solution viable pour l’environnement ?
Si la publicité contribue à la surconsommation, sa suppression totale poserait d’autres problèmes sociétaux majeurs. Elle finance en grande partie les contenus gratuits sur internet ainsi que la presse et l’information indépendante. Un monde sans publicité pourrait conduire à un accès à l’information plus inégalitaire, réservé à ceux qui peuvent payer.
« Le souci, c’est que effectivement, ils oublient l’autre pan. Le fait que la pub bah ça finance tous nos usages gratuits sur le sur le web et ça finance l’information indépendante aussi. » – Adeline Gabet